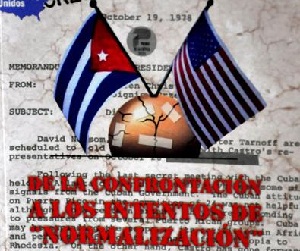 L’ouvrage nous propose une analyse des tentatives de normalisation sous les administrations de Gerald Ford (1974-1977) et de Jimmy Carter (1977-1981).
L’ouvrage nous propose une analyse des tentatives de normalisation sous les administrations de Gerald Ford (1974-1977) et de Jimmy Carter (1977-1981).
À une occasion, le président Raul Castro a déclaré que « nous avons été capables de faire l’Histoire mais nous avons été incapables de l’écrire ».
L’excellent livre d’Elier Ramirez et d’Estaban Morales « De la confrontacion a los intentos de “normalizacion” » (De la confrontation aux tentatives de « normalisation ») (aux Éditions de Sciences sociales, 2014) est venu combler ce vide.Cet ouvrage, écrit à l’aide de sources secondaires étasuniennes et cubaines, et enrichi d’extraits de documents étasuniens, et aussi – ce qui est nouveau – de nombreux documents cubains, propose une analyse des tentatives de normalisation sous les administrations de Gerald Ford (1974-1977) et de Jimmy Carter (1977-1981), les seuls présidents, avant Barack Obama, ayant sérieusement tenté de normaliser les relations entre les deux pays. Il y eut également une tentative sous Kennedy, décrite par Ramirez et Morales dans le premier chapitre du livre.Aussi bien sous Ford que sous Carter, l’Afrique fut, comme l’expliquent très bien les auteurs, « l’écueil insurmontable » à la normalisation entre les États-Unis et Cuba.
La progression des négociations fut interrompue en 1975 par l’arrivée des troupes cubaines en Angola, au grand dam de l’URSS, de l’Afrique du Sud qui avait envahi l’Angola jusqu’aux abords de Luanda, la capitale, et des États-Unis qui agissaient de connivence avec Pretoria.Fidel décida d’intervenir, conscient que la victoire de l’axe du mal – Washington et Pretoria – aurait signifié la victoire de l’apartheid, le renforcement de la domination blanche sur les peuples d’Afrique australe.
Quinze ans plus tard, faisant preuve d’une honnêteté inhabituelle, Henry Kissinger, Secrétaire d’État des États-Unis en 1975, a reconnu dans son dernier livre de mémoires que Cuba était intervenue de sa propre initiative, mettant l’URSS devant le fait accompli. « Fidel était probablement le leader révolutionnaire au pouvoir le plus authentique à cette époque », soulignait Kissinger.
Cuba a sauvé l’Angola et les États-Unis se sont vengés en interrompant les conversations sur la normalisation des relations. Par la suite, les discussions furent reprises sous Carter. Ramirez et Morales nous livrent des détails sur les communications entre les fonctionnaires étasuniens et cubains en 1977-78. Sous une plume habile et perspicace, ils utilisent aussi bien des documents cubains que nord-américains, un exploit exceptionnel qu’aucun autre historien n’a réussi, pas même l’auteur de ces lignes.
Une fois de plus, l’Afrique fut « l’écueil insurmontable ». Fin 1977, les troupes cubaines débarquaient en Éthiopie pour aider à repousser l’invasion somalienne. Ce qui se produisit relève de l’univers de Macondo, le village mythique de l’écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez : le gouvernement de Carter condamna Cuba pour avoir dépêché des troupes pour stopper un agresseur résolu à dépecer l’Éthiopie, au mépris de toutes les normes du Droit international.
Cependant, comme le démontre l’historienne Nancy Mitchell dans un livre très documenté qui mériterait d’être publié à Cuba, Carter, ce « bon » président, avait lui-même encouragé l’agression de la Somalie contre l’Éthiopie, dans un calcul cynique enraciné dans la mentalité de la guerre froide. Les États-Unis virent leurs rapports se dégrader avec l’Éthiopie, dont le gouvernement sympathisait avec le bloc socialiste, et ils saisirent l’occasion qui leur fut offerte de former alliance avec la Somalie. La manière de l’obtenir était d’aider le président somalien Siad Barre dans ses efforts d’agression. Des années plus tard, Jimmy Carter devait déclarer à Nancy Mitchell : « Moralement, nous avons fait le mauvais choix car nous soutenions Siad Barre qui avait envahi l’Éthiopie ». (Nancy Mitchell a enregistré la conversation avec Carter, qui a duré plus de deux heures, et j’ai moi-même eu le privilège d’écouter cet enregistrement). Mais plus que l’Éthiopie, l’écueil insurmontable fut l’Angola.
Carter exigea le départ des troupes cubaines. Mais même la CIA a reconnu que la présence des troupes cubaines « était nécessaire pour préserver l’indépendance de l’Angola », menacée par l’Afrique du Sud de l’apartheid. Mais cela n’a pas suffi à satisfaire l’arrogance impériale de Washington.Les États-Unis, qui maintenaient des centaines de milliers de soldats dans les pays d’Europe occidentale pour les défendre d’une éventuelle menace soviétique, ne toléraient pas que l’Angola puisse accueillir des troupes cubaines pour le défendre de la menace bien réelle de l’Afrique du sud. Comme l’a dit Fidel à deux envoyés de Carter en décembre 1978, les États-Unis « semblaient prétendre qu’il existe deux lois, deux systèmes de règles et deux types de logique : une pour eux et l’autre pour les autres pays », une triste vérité datant des temps de Thomas Jefferson et qui continue de nos jours.
Cuba refusa de céder au chantage de Carter, qui posait des conditions à une normalisation, dont le retrait des troupes cubaines d’Angola. Les pressions de James Carter ne purent changer « la position ferme et catégorique de Cuba », devait déclarer Jorge Risquet, l’homme de confiance de Fidel en Angola, au président de ce pays d’Afrique, Agostinho Neto. « La présence cubaine en Angola est une affaire qui n’incombe qu’à nos deux pays, et elle ne fera l’objet d’aucune négociation entre Cuba et les États-Unis ».
En lisant ces mots, je ne peux m’empêcher de penser à la dette immense du peuple angolais et de son gouvernement envers Cuba. J’ai également pensé à Risquet, qui a toujours insisté pour me dire que la politique cubaine en Angola avait été tracée par Fidel et Raul, et qu’il ne faisait que suivre leurs instructions. Mais même une politique géniale a besoin de quelqu’un capable de l’exécuter correctement sur le terrain. Pour ce faire, il y avait des hommes comme Polo Cintra Frias, pour la partie militaire, et Jorge Risquet pour la partie politique. Je voudrais également livrer une réflexion personnelle : pour moi, Risquet fut un frère.
Pendant plus de 20 ans, j’ai pu admirer la sagesse, l’intelligence et l’honnêteté de ce magnifique révolutionnaire, dévoué aussi bien à la cause qu’à ces leaders, Fidel et Raul Castro.Le livre de Ramirez et de Morales est l’une des œuvres les plus importantes sur la politique extérieure de la Révolution qui ait été publiée durant ces dernières décennies à Cuba et à l’étranger. Les auteurs nous livrent d’une façon magistrale la preuve irréfutable de la noblesse et de la générosité de la politique extérieure cubaine. Leur analyse est claire, rigoureuse et basée sur les faits réels. * Piero Gleijeses est membre et correspondant étranger de l’Académie d’Histoire de Cuba et professeur de politique extérieure des États-Unis à l’Université Johns Hopkins à Washington.
(Granma)